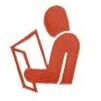Voici ce qui se passe quand vous regardez Oui de Nadav Lapid : vous vous retrouvez dans cette position épistémologique bizarre, typique du spectateur de cinéma d’auteur post-2010 où vous n’êtes pas tout à fait sûr si le film est (a) brillamment subversif d’une manière qui vous échappe parce que vous êtes trop conditionné par Hollywood, (b) complètement vide mais emballé dans suffisamment de tics formels pour simuler la profondeur, ou (c), et c’est l’hypothèse la plus terrifiante, intentionnellement vide comme geste critique, ce qui signifierait que votre confusion et votre ennui font partie de l’expérience esthétique planifiée, rendant toute critique du film non seulement invalide mais en fait la preuve de son succès.
C’est le piège parfait du méta-cinéma contemporain : plus vous le détestez, plus il vous possède.
Mais, Parlons de l’éléphant dans la salle, ou plutôt, de l’éléphant qui n’est pas dans la salle, qui est justement le problème. Oui se déroule en 2024, en pleine offensive israélienne sur Gaza, et pourtant Gaza « existe » dans le film: Y’a de la fumée noire au loin. Des bruits à la télé. C’est tout. C’EST COMME FAIRE UN FILM SUR LA SHOAH VU DEPUIS UNE BOÎTE DE NUIT À BERLIN.
Alors c’est quoi ce bazar ? Un problème moral abstrait pour des Israéliens de classe moyenne-supérieure. Une excuse narrative pour que le protagoniste Y puisse avoir sa crise existentielle d’artiste.
Et voici ce qui est vicieux dans la construction du film : Lapid sait qu’il fait ça. Le film est conscient de sa propre cécité. Il théâtralise l’incapacité de la société israélienne à voir les Palestiniens. Mais cette conscience réflexive ne rachète rien, elle aggrave tout. Parce que maintenant ce n’est plus seulement un film qui ignore les victimes palestiniennes ; c’est un film qui ignore les victimes palestiniennes tout en étant très fier de remarquer qu’il les ignore.
C’est le summum de ce qu’on pourrait appeler l’engagement performatif : le geste de dénonciation remplace la dénonciation elle-même. Lapid filme des Israéliens qui dansent pendant que Gaza brûle, et nous sommes censés applaudir son courage pour avoir montré cette danse. Mais montrer n’est pas examiner. Théâtraliser n’est pas comprendre. Et surtout, surtout, se distancier ironiquement de la complicité n’est pas la même chose que de ne pas être complice.
Le film devient ainsi une forme sophistiquée d’exonération morale : en représentant les Israéliens comme fondamentalement incapables de voir ce qu’ils font, Lapid les transforme d’acteurs moraux en symptômes psychologiques. Vous ne pouvez pas blâmer quelqu’un pour un aveuglement structurel, n’est-ce pas ? C’est tragique, pas criminel. C’est existentiel, pas politique. Et voilà comment un film qui prétend dénoncer le génocide finit par dépolitiser complètement ce génocide, le transformant en toile de fond pour un drame bourgeois sur l’anxiété de l’artiste sensible.
Il y a une scène au milieu du film, je ne me souviens plus exactement laquelle parce qu’elles se fondent toutes dans une bouillie indifférenciée de plans significatifs et de gros plans déformants, où la caméra fait cette chose où elle zoome très rapidement sur le visage du protagoniste pendant qu’il parle, puis dézoome tout aussi rapidement, puis recommence, créant cette sensation physique inconfortable que vous êtes censé interpréter soit comme de l’aliénation, du désarroi psychologique (et c’est bien sûr bien envoyé !), soit comme de la virtuosité cinématographique.
Voici la liste non exhaustive de ce que Lapid fait pendant 115 minutes :
Plans saccadés qui ne construisent aucun rythme, juste de l’arythmie, zooms agressifs sur des visages, comme s’il suffisait de mettre la caméra assez près pour révéler quelque chose, musique électronique criarde pendant des scènes de fête qui sont censées révéler la décadence morale mais qui ressemblent juste à… des fêtes, dialogue hurlé à vitesse maximale, comme si le volume et la rapidité équivalaient à l’urgence, symbolisme lourdingue (le canard sur l’épaule, sérieusement ?), séquences oniriques qui arrivent sans préparation et partent sans résolution. C’est l’esthétique du clip vidéo indie-rock circa 2003, mais avec des prétentions au Cinéma d’Art. C’est du Michel Gondry sans la douceur. C’est du Gaspar Noé sans la conviction viscérale. C’est du chaos formel qui croit que l’agitation est la même chose que l’énergie, et que l’inconfort visuel est la même chose que la provocation intellectuelle.
Le problème n’est pas que c’est « mal tourné » au sens technique, Lapid sait clairement ce qu’il fait avec une caméra. Le problème est que c’est mal pensé, mal construit, mal justifié. Chaque choix formel semble exister pour sa propre démonstration plutôt que pour servir une logique narrative ou émotionnelle cohérente. Et voici le vrai vice : cette esthétique du chaos protège le film de la critique. Parce que si vous dites « je n’ai pas compris », le défenseur du film peut répondre « c’est justement le point, vous êtes censé vous sentir désorienté. » Si vous dites « je me suis ennuyé », ils disent « le film interroge justement les limites de l’attention dans la société du spectacle. » Si vous dites « c’était gratuit et indulgent », ils disent « vous avez juste besoin de récits conventionnels. »
C’est la critique-preuve parfaite : chaque objection devient une preuve supplémentaire de la sophistication du film.
Mais passons à la question inconfortable : pour qui ce film existe-t-il ? Qui est le public de Oui ? Pas les Israéliens qui soutiennent la guerre , ils ne verront jamais ce film, et s’ils le voient, ils le rejetteront comme de la propagande anti-israélienne. Pas les Palestiniens, qui sont absents du film sauf comme fumée et bruit, et pour qui ce portrait de l’angoisse israélienne doit sembler obscènement narcissique. Pas le grand public, qui ne supportera pas 115 minutes de caméra agitée et de symbolisme opaque.
Non, le public de Oui est l’intelligentsia internationale du festival de cinéma : les critiques européens, les programmateurs, les cinéphiles qui veulent se sentir politiquement engagés sans avoir à faire face aux véritables complexités ou coûts de cet engagement. C’est un film fait pour des gens qui sont déjà d’accord avec ses prémisses de base, qui peuvent hocher la tête tristement devant la « tragédie » de la société israélienne aveugle, qui peuvent applaudir le « courage » de Lapid pour avoir fait ce film, et qui peuvent ensuite rentrer chez eux en se sentant légèrement plus vertueux sans que rien dans leur vie ou leurs croyances n’ait été fondamentalement remis en question.
C’est de l’art de complaisance déguisé en art de confrontation. C’est de la subversion sans risque. C’est du radicalisme de festival. Et le plus triste est que Lapid est capable de mieux. Synonymes (2019), son film précédent, avait une vraie colère, une vraie étrangeté, une vraie volonté de se mettre lui-même, et pas seulement ses personnages en danger. Ce film sentait le dangereux, l’imprévisible, le nécessaire.
Oui sent le calculé, le sûr, le préemballé pour l’approbation critique. C’est le film qu’un cinéaste fait quand il veut prouver son engagement politique sans risquer d’aliéner le circuit des festivals. Voici ce que je continue à penser à propos de Oui : c’est un film sur le vide qui est lui-même vide. C’est un film sur l’incapacité à dire quelque chose de significatif qui est lui-même incapable de dire quelque chose de significatif. C’est un film sur la complicité morale qui est lui-même moralement complice.
Et oui, je sais : vous pourriez dire que c’est intentionnel, que le film incarne le problème qu’il diagnostique, que sa forme est son contenu. Mais cette défense ne fonctionne que si l’incarnation produit une illumination, un moment de reconnaissance ou de compréhension qui n’existait pas avant. Oui ne produit pas d’illumination. Il produit de l’épuisement. De la confusion. De l’irritation. Et finalement, de l’indifférence.
Le film crie « Non ! » à la folie, mais sa seule vraie réponse est un « Oui » à l’hystérie esthétique qui laisse le spectateur lessivé et le propos,malheureusement, tragiquement, complètement intact. Lapid a fait un film sur l’incapacité de la société israélienne à voir ce qu’elle fait. Mais il a échoué à voir ce que son film fait : transformer une catastrophe politique réelle en simple décor pour une crise existentielle bourgeoise, habiller la complicité morale en tourment artistique, et finalement dépolitiser précisément ce qu’il prétend politiser.
C’est de l’engagement fantôme. C’est de la dénonciation sans dents. C’est de l’art qui se regarde dans le miroir et appelle ça du courage. Et le plus triste ? Il sera probablement nommé pour des prix.
P.S. : Le canard, il sert vraiment à rien. Vraiment. C’est juste pour que les critiques écrivent « le canard, métaphore de l’absurdité contemporaine ». Non. C’est juste un canard. Arrêtez.