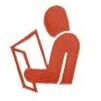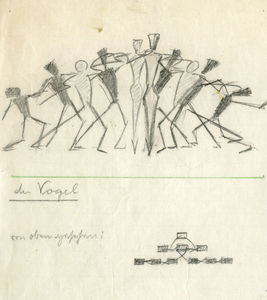L’Ambiguïté Créatrice de Pina Bausch : Entre Héritage Expressionniste et Subversion Contemporaine
L’œuvre de Pina Bausch (1940-2009) occupe une position paradoxale dans l’histoire de la danse contemporaine. Héritière directe de l’école expressionniste allemande fondée par Rudolf Laban et Mary Wigman, elle transforme radicalement cet héritage tout en portant les traces ambivalentes de ses origines historiques. Cette filiation complexe soulève des questions troublantes sur la persistance, dans l’esthétique bauschienne, d’une vision du monde marquée par la conflictualité et la violence des rapports interhumains.
Les Racines Troubles de l’Expressionnisme Allemand
La danse expressionniste allemande naît dans les années 1910-1920 avec Rudolf Laban et son élève Mary Wigman. Bien que la danse expressionniste trouve ses origines dans la danse moderne initiée par Rudolf Laban, c’est plutôt son élève Mary Wigman qui est considérée comme sa vraie fondatrice. Cette école prône une libération du corps et de l’expression face aux conventions du ballet classique, dans un contexte de bouleversements sociaux et politiques majeurs.
Cependant, l’histoire de ce mouvement révèle des compromissions troublantes avec l’idéologie nazie. Mary Wigman, figure centrale de cette esthétique, est tombé en discrédit après avoir été accusé de collaborer avec le parti nazi
.Cette proximité n’est pas anecdotique : elle révèle comment l’expressionnisme corporel allemand, avec son culte de l’authenticité primitive et sa fascination pour les forces irrationnelles, a pu résonner avec l’idéologie völkisch et ses obsessions identitaires.
L’esthétique expressionniste valorise l’instinct contre la raison, l’émotion brute contre la sophistication, le primitif contre le civilisé. Ces oppositions binaires, portées par une vision essentialiste de l’identité corporelle et culturelle, nourrissent une weltanschauung fondée sur la « guerre de tous contre tous » hobbesienne. Le corps devient le lieu d’une vérité supposée plus authentique que la parole, mais cette authenticité masque souvent une brutalité idéologique.
L’Héritage Ambigu de Pina Bausch
Pina Bausch est née en Allemagne en 1940. Formée à Essen à la Folkwang Hochschule de Kurt Jooss ainsi qu’aux États-Unis à la Juilliard School of Music de New York, son expérience personnelle se situe au croisement de deux courants esthétiques : l’héritage de la danse expressionniste et la modern dance américaine. Cette double formation révèle déjà la complexité de son positionnement artistique.
Bausch invente le concept de « Tanztheater » (danse-théâtre), introduit le concept de danse-théâtre. Encensée mais également décriée, ils sont nombreux à voir en elle « l’impératrice d’un expressionnisme métaphysique ». Cette appellation d' »impératrice d’un expressionnisme métaphysique » n’est pas neutre : elle souligne la persistance, dans son œuvre, d’une vision du monde marquée par l’intensité dramatique et la conflictualité existentielle.
La Pauvreté Conceptuelle : Anatomie d’un Succès Factice
Au-delà de ses implications idéologiques problématiques, l’œuvre de Pina Bausch révèle une pauvreté conceptuelle dissimulée derrière un appareil spectaculaire. L’examen attentif de ses procédés chorégraphiques met au jour la répétition mécanique de formules éprouvées, transformées en marques de fabrique par une industrie culturelle en quête de produits identifiables et commercialisables.
La Mécanique de la Répétition : Quand l’Innovation Devient Système
L’esthétique bauschienne repose sur un nombre limité de procédés récurrents qui, une fois identifiés, révèlent leur caractère systématique et, partant, leur indigence créative. Cette mécanique s’articule autour de plusieurs éléments invariants :
La Répétition Compulsive : Dans chaque pièce, les danseurs répètent inlassablement les mêmes gestes, les mêmes déplacements, les mêmes interactions. Cette répétition, présentée comme révélatrice de l’absurdité existentielle, devient rapidement un procédé paresseux qui dispense de tout développement dramaturgique véritable. Dans « Café Müller », les protagonistes renversent et redressent les mêmes chaises pendant quarante minutes. Cette « profondeur » supposée masque une incapacité à construire un propos chorégraphique évolutif.
L’Épuisement Physique Spectaculaire : L’exhibition de la fatigue des danseurs, leurs corps en sueur, leurs respirations haletantes, leur épuisement visible sont systématiquement exploités comme marqueurs d’authenticité. Cette esthétique de l’épuisement, censée révéler une vérité corporelle brute, relève en réalité d’un voyeurisme déguisé en profondeur artistique. Le public consomme la souffrance des interprètes comme garantie d’un art « vrai », sans s’interroger sur la vacuité du propos ainsi véhiculé.
La Panoplie des Stéréotypes Genrés : Malgré ses prétentions subversives, l’œuvre bauschienne reproduit ad nauseam les clichés les plus éculés sur les rapports hommes-femmes. Les femmes y sont invariablement victimes, fragiles, hystériques ou séductrices manipulatrices. Les hommes oscillent entre brutalité primitive et faiblesse pathétique. Cette vision binaire et réductrice des identités sexuelles, loin de questionner les stéréotypes, les renforce par leur omniprésence obsessionnelle.
L’Imposture du « Théâtre-Danse » : Ni Théâtre Ni Danse
Le concept de « Tanztheater » dont Bausch se prétend l’inventrice révèle, à l’analyse, sa nature hybride et bâtarde. Incapable de développer un langage chorégraphique autonome, l’esthétique bauschienne se réfugie dans un mélange approximatif qui trahit une double incompétence.
L’Absence de Dramaturgie : Les « pièces » de Bausch ne possèdent aucune structure dramatique cohérente. Elles juxtaposent des séquences arbitraires reliées par le seul fil conducteur de leur ressemblance formelle. Cette absence de construction révèle une incapacité à penser l’œuvre comme totalité signifiante. Le spectateur assiste à une succession de variations sur un même thème obsessionnel, sans progression ni résolution.
La Pauvreté du Vocabulaire Chorégraphique : Contrairement aux grands créateurs de la danse moderne (Graham, Cunningham, Forsythe), Bausch ne développe aucun langage corporel spécifique. Ses danseurs évoluent dans un registre gestuel emprunté au quotidien, sans transfiguration artistique véritable. Cette esthétique du « naturel » masque une indigence technique et une absence de recherche sur le mouvement comme langage autonome.
La Surcharge Décorative : Quand le Spectaculaire Supplée au SensL’œuvre bauschienne compense sa pauvreté conceptuelle par une surcharge d’effets spectaculaires qui visent à impressionner le spectateur et à masquer la vacuité du propos central.
La Scénographie Tape-à-l’Œil : Chaque production bauschienne multiplie les effets visuels : pluie artificielle, tonnes de terre, montagnes de fleurs, animaux vivants. Cette accumulation d’éléments hétéroclites crée une impression de richesse qui dissimule l’absence de nécessité dramatique. Dans « Vollmond », la scène inondée d’eau ne répond à aucune logique interne si ce n’est celle de l’effet de surprise et du « jamais vu ».
L’Exotisme de Pacotille : Les « cycles » géographiques de Bausch (cycle Palermo, cycle indien, cycle sud-américain) révèlent un rapport touristique et superficiel aux cultures explorées. Ces œuvres accumulent les clichés ethnographiques les plus convenus sans jamais approfondir leur compréhension des sociétés visitées. « Bamboo Blues » sur l’Inde ou « Agua » sur le Brésil reproduisent les stéréotypes orientalistes les plus éculés.
La Manipulation Émotionnelle : L’Art Réduit à ses EffetsL’esthétique bauschienne privilégie systématiquement l’effet émotionnel immédiat sur la construction de sens. Cette stratégie révèle une conception instrumentale de l’art, réduit à sa capacité de produire des émotions fortes chez le spectateur.
L’Exploitation de la Nostalgie : Bausch exploite systématiquement les ressorts de la mélancolie et de la nostalgie, émotions faciles à déclencher et universellement accessibles. Ses univers saturés de regret et de perte infantilisent le spectateur en sollicitant ses affects les plus primitifs. Cette complaisance dans le pathétique dispense de tout effort de construction intellectuelle.
Le Pathos comme Substitut au Logos : L’intensité émotionnelle devient chez Bausch l’unique critère de validation artistique. Cette primauté du pathos sur le logos révèle une conception anti-intellectuelle de l’art qui flatte les instincts les plus grégaires du public. L’émotion brute remplace la réflexion, le ressenti supplante l’analyse.
L’Imposture Critique : Quand la Complaisance Tient Lieu d’Analyse
Le succès de Pina Bausch s’explique largement par la complaisance d’une critique incapable d’analyser objectivement ses procédés. Cette cécité critique révèle les dysfonctionnements d’un milieu intellectuel subjugué par les effets de mode et incapable de distinguer l’innovation véritable de sa simulation.
Le Conformisme Déguisé en Subversion : L’œuvre bauschienne, présentée comme révolutionnaire, reproduit en réalité les attentes les plus convenues du public bourgeois contemporain : pessimisme existentiel, esthétisation de la souffrance, exotisme décoratif. Cette pseudo-subversion permet au spectateur de se donner l’illusion de la transgression sans remise en cause véritable de ses catégories mentales.
L’Évitement du Politique : Malgré ses prétentions critiques, l’univers bauschien évacue soigneusement toute dimension politique explicite. Ses « dénonciations » de la violence sociale restent suffisamment abstraites pour ne déranger aucun pouvoir établi. Cette neutralisation politique explique son succès institutionnel : Bausch critique « l’humanité » en général sans jamais nommer les responsabilités particulières.
Conclusion : L’Art à l’Ère de sa Reproductibilité Mécanique
L’analyse de l’œuvre de Pina Bausch révèle les mécanismes par lesquels l’industrie culturelle contemporaine transforme quelques procédés initialement novateurs en formules reproductibles et commercialisables. Cette transformation de l’art en marchandise standardisée explique le succès international d’une esthétique qui flatte les attentes du public sans jamais les dépasser.
La « révolution » bauschienne illustre parfaitement ce que Benjamin appelait l’art à l’ère de sa reproductibilité technique : la substitution de l’effet à l’œuvre, du sensationnel au sens, de la consommation émotionnelle à l’expérience esthétique véritable. Dans cette perspective, Pina Bausch apparaît moins comme une créatrice que comme une productrice d’effets artistiques calibrés pour un marché culturel mondialisé.
Cette critique ne vise pas à nier l’impact historique de Bausch sur l’évolution de la danse contemporaine, mais à révéler les limites et les impasses d’une esthétique devenue système. Comprendre ces mécanismes permet de distinguer l’innovation véritable de sa simulation marchande et de restituer à l’art contemporain ses exigences critiques authentiques.